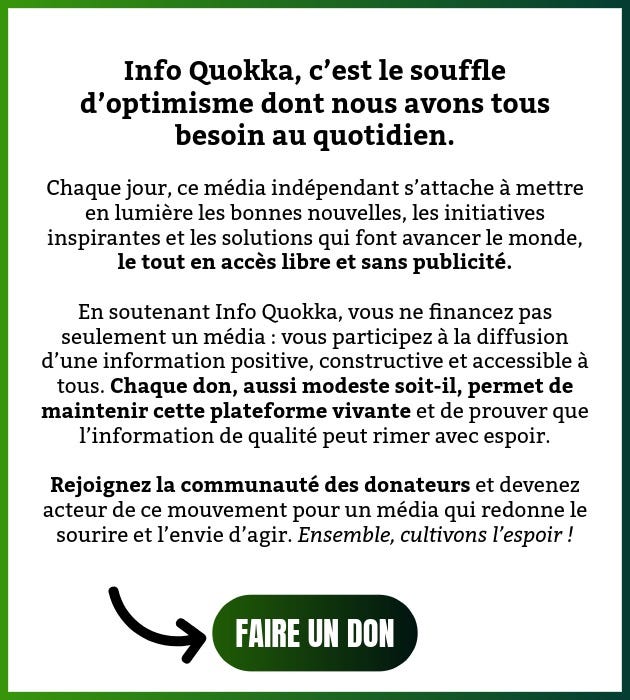Cicatrisation parfaite : le mystère biologique enfin élucidé ?
Des chercheurs comme le Dr Longaker pourraient bientôt révolutionner la cicatrisation. Découvrez comment effacer les cicatrices grâce à la science et à des décennies de recherche.

En 1979, le Dr Michael Longaker, alors étudiant à l’Université d’État du Michigan, partageait le terrain de basket avec la légende Earvin « Magic » Johnson. À l’époque, il rêvait de sport, non de science. Pourtant, c’est dans un laboratoire, presque par accident, qu’il découvrit sa vocation. Aujourd’hui, ce chirurgien plasticien est l’un des chercheurs les plus influents au monde dans l’étude des cicatrices. Son objectif ? Permettre à l’humanité de guérir sans traces, comme dans le ventre maternel.
La découverte qui a tout changé : une cicatrisation sans cicatrice
Tout a commencé dans le laboratoire du Dr Michael Harrison, un chirurgien pédiatrique qui opérait des fœtus in utero. Longaker, alors réticent à la recherche, observa un phénomène fascinant : les bébés opérés avant la naissance ne présentaient aucune cicatrice. Harrison lui lança alors un défi : « Pourquoi ne pas étudier notre processus de guérison avant la naissance ? »
Cette question devint l’obsession de Longaker. Pendant quatre ans, il opéra des fœtus d’agneaux et d’autres animaux, explorant les mécanismes de la « cicatrisation sans cicatrice ». Il découvrit que, jusqu’à un certain stade de développement, les blessures guérissent sans laisser de trace. Mais après 24 semaines de gestation chez l’humain, le processus de cicatrisation s’enclenche — et les cicatrices deviennent inévitables.
Pourquoi les cicatrices se forment-elles ?
Les cicatrices sont le résultat d’un processus complexe. Lorsqu’une blessure survient, le corps forme un caillot, envoie des cellules immunitaires, puis active des fibroblastes — des cellules qui produisent du collagène pour réparer la peau. Mais parfois, ces fibroblastes s’emballent, produisant trop de collagène et créant des cicatrices épaisses ou rétractiles.
Le Dr Paul Martin, biologiste cellulaire à l’Université de Bristol, explique : « Les fibroblastes sont comme des ouvriers sur un chantier. Si les signaux sont trop forts, ils construisent une cicatrice au lieu de restaurer la peau normale. » Chez les embryons, ces signaux sont différents, permettant une régénération parfaite.
Les pistes prometteuses pour effacer les cicatrices
Aujourd’hui, les chercheurs explorent plusieurs pistes pour réactiver cette capacité de régénération :
Les fibroblastes « en colère » : Longaker a identifié une sous-population de fibroblastes qui s’activent pendant la cicatrisation. En les bloquant chez des souris adultes, les cicatrices ont disparu.
La protéine YAP : Une molécule sensible à la tension mécanique dans les plaies. En l’inhibant, des souris et des porcs ont cicatrisé sans cicatrices.
La décorine et l’IA : Des pansements en gel chargés de décorine, une protéine naturelle, sont testés sur des brûlures. L’intelligence artificielle aide aussi à concevoir de nouvelles molécules anti-cicatrices.
Le professeur Liam Grover, de l’Université de Birmingham, souligne : « Nous cherchons des solutions ciblées, sans affaiblir le système immunitaire. »
Un espoir pour des millions de personnes
Les cicatrices ne sont pas qu’un problème esthétique. Elles peuvent limiter les mouvements, affecter la parole, ou rappeler des traumatismes. Au Royaume-Uni, 5 millions de personnes souffrent de cicatrices douloureuses.
Longaker reçoit des centaines d’emails chaque mois de patients désespérés. « Nous sommes à un tournant, déclare-t-il. Les rails sont posés. » Les essais cliniques en cours pourraient bientôt offrir des solutions concrètes.
Vers un futur sans cicatrices ?
La science avance, mais la route est encore longue. Les chercheurs doivent affiner leurs cibles moléculaires et tester leurs découvertes sur l’humain. Pourtant, l’espoir est permis. Comme le dit Longaker : « Je n’abandonnerai pas. »
Un jour, peut-être, les cicatrices ne seront plus qu’un lointain souvenir.