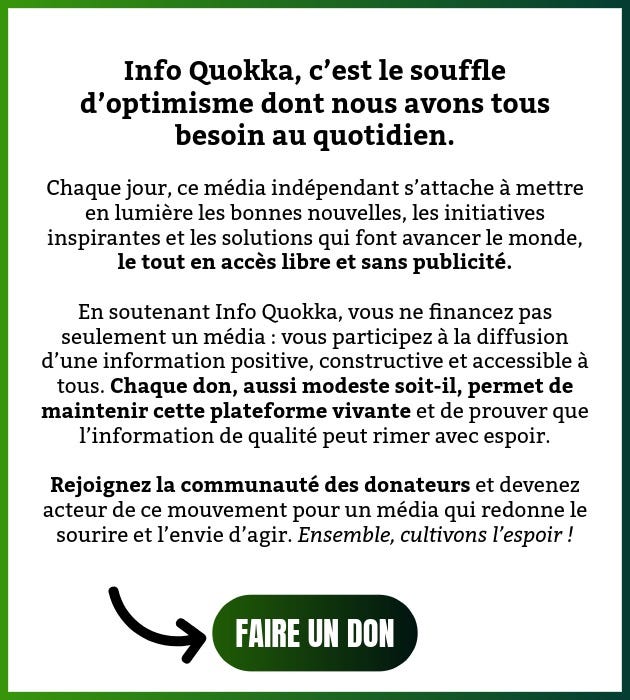COP30 : comment les communautés indigènes transforment les négociations climatiques
La COP30 à Belém met en lumière les peuples autochtones, acteurs clés de la lutte climatique. Découvrez leurs initiatives, leurs défis et leur rôle historique dans la protection de l’Amazonie.

Pour la première fois de son histoire, la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP30, se tient en plein cœur de l’Amazonie, à Belém. Un choix symbolique et stratégique, qui place les peuples autochtones au centre des débats. Avec 3 000 représentants indigènes attendus, cette édition marque un tournant : leurs savoirs traditionnels et leur combat pour la préservation des écosystèmes sont enfin reconnus comme des leviers essentiels contre le réchauffement climatique.
3 000 autochtones à la COP30 : une présence historique
Jamais une COP n’avait accueilli autant de représentants autochtones. Parmi eux, 1 000 participeront directement aux négociations officielles dans la « zone bleue », tandis que 2 000 autres animeront la « zone verte », espace dédié à la société civile. Une visibilité sans précédent, rendue possible par l’engagement du gouvernement brésilien, qui a multiplié les initiatives pour amplifier leur voix.
Sônia Guajajara, ministre brésilienne des Peuples autochtones, insiste : « Nous travaillons sur des solutions pour atténuer la crise climatique, et il est prouvé que les territoires et les peuples autochtones sont ceux qui préservent le mieux la biodiversité. » Leur présence massive à Belém n’est pas un hasard : elle reflète une volonté politique de reconnaître leur rôle clé dans la protection de l’environnement.
Un fonds de 125 milliards de dollars pour les forêts tropicales
Le Brésil propose la création du Fonds pour la préservation éternelle des forêts tropicales (TFFF), doté de 125 milliards de dollars. 20 % de cette somme sera réservée aux communautés autochtones, une première. La Norvège a déjà promis 3 milliards de dollars, montrant l’engagement international.
Ce fonds vise à financer la protection des forêts, mais aussi à soutenir les modes de vie indigènes, reconnus comme les plus efficaces pour lutter contre la déforestation. En 2024, les terres autochtones ne représentaient que 1,3 % de la déforestation totale au Brésil, preuve de leur impact positif.
Le Pavillon du Cercle des Peuples : un espace de dialogue et de résistance
Au cœur de la zone verte, le Pavillon du Cercle des Peuples offre une plateforme aux communautés indigènes, afro-descendantes et paysannes. Coordonné par Sônia Guajajara et Anielle Franco, ministre de l’Égalité raciale, cet espace permet de partager des solutions concrètes et de sensibiliser les décideurs.
« Leur mode de vie contribue à l’équilibre climatique », rappelle Guajajara. Le pavillon accueille débats, expositions et ateliers, tandis que la Fondation nationale pour les peuples autochtones (FUNAI) organise un festival de cinéma et un marché de produits locaux. Une façon de montrer que la protection de la nature rime avec développement durable.
Former les diplomates autochtones : le programme « Kuntari Katu »
Pour préparer les représentants indigènes aux négociations, le Brésil a lancé le programme « Kuntari Katu » (« celui qui parle pour le peuple » en nhengatú). Des cours de langue et des formations sur les enjeux climatiques ont été dispensés, afin de leur donner les outils pour influencer les discussions.
André Guimarães, directeur de l’IPAM, souligne l’importance de cette présence : « Les négociateurs sont influencés par ce qu’ils voient hors des salles. Les revendications autochtones pèsent sur les décisions. » Une stratégie payante, alors que les communautés indigènes subissent de plein fouet les effets du changement climatique.
Des territoires autochtones, remparts contre la déforestation
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les terres indigènes couvrent 13,8 % du Brésil, mais ne représentent que 1,3 % de la déforestation. Leur gestion durable protège les écosystèmes et stocke d’énormes quantités de CO₂.
Depuis 2023, le président Lula da Silva a reconnu 16 nouveaux territoires autochtones, renforçant leur autonomie. Un signal fort, alors que la création d’un ministère dédié – dirigé par Guajajara – marque une avancée historique.
Un héritage pour les générations futures
La COP30 à Belém est bien plus qu’une conférence : c’est un moment charnière pour la justice climatique. En donnant la parole aux peuples autochtones, le Brésil montre la voie. Leur inclusion dans les processus décisionnels n’est plus une option, mais une nécessité.
Comme le résume Guajajara : « Il est impossible d’envisager des solutions sans ceux qui protègent l’environnement. » Leur combat est celui de la planète entière.
Et vous, pensez-vous que les savoirs autochtones pourraient inspirer d’autres pays dans la lutte contre le réchauffement climatique ?