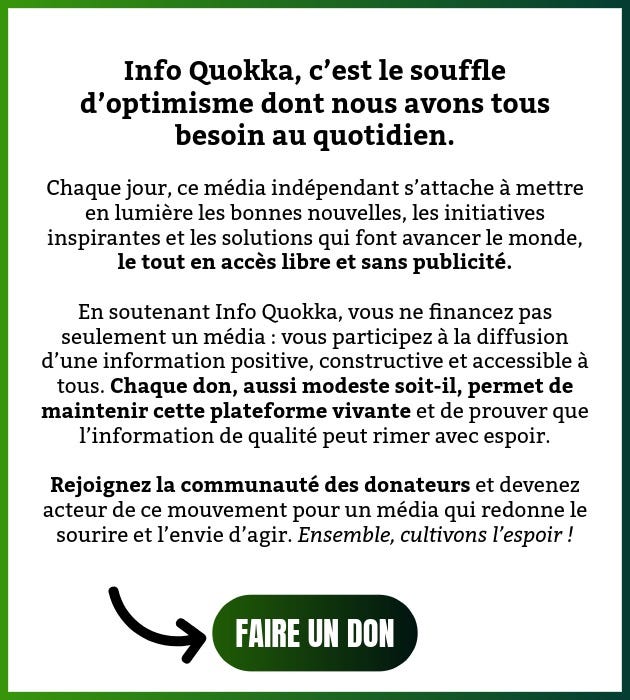La « Petting Army » : l’arme secrète contre la cyberhaine aux Pays-Bas
Face à la hausse des attaques haineuses en ligne pendant les élections néerlandaises, 2 000 citoyens utilisent la « Petting Army » pour inonder les réseaux de messages positifs.

Les élections néerlandaises du 29 octobre s’annonçaient sous le signe de la tension, si une initiative citoyenne ne venait pas bousculer les codes. Depuis le début de la campagne, les attaques haineuses en ligne contre les personnalités politiques se multiplient, poussant certains élus à annuler des apparitions publiques. Pourtant, face à cette vague de toxicité, plus de 2 000 Néerlandais ont choisi une arme inattendue : la gentillesse. Leur méthode ? La « Petting Army », une armée de « caresses » numériques.
La haine en ligne, un fléau en hausse pendant les élections
Les Pays-Bas ne font pas exception à la règle : les campagnes électorales exacerbent les tensions, et les réseaux sociaux deviennent le terrain de jeu des discours de haine. Selon les autorités, les menaces contre les hommes et femmes politiques ont fortement augmenté depuis le début de la campagne. Certains candidats ont même dû renoncer à des meetings par crainte d’agressions. La protection des principaux candidats a été renforcée, mais comment endiguer la haine en ligne ?
Les réseaux sociaux, amplificateurs de polarisation, transforment chaque prise de position en champ de bataille. Les algorithmes favorisent les contenus clivants, et les messages haineux, souvent plus engagés, gagnent en visibilité. Une spirale toxique qui décourage les débats constructifs et met en danger la démocratie.
La « Petting Army » : une réponse citoyenne et ingénieuse
C’est dans ce contexte qu’est née la « Petting Army » (littéralement, l’« armée des caresses »), une initiative portée par le mouvement « Semeurs d’espoir » (Hoopzaaiers). Le principe ? Dès qu’un·e politique est la cible de messages haineux, des centaines de bénévoles envoient des messages positifs pour noyer la toxicité. « Nous voulons montrer que nous sommes plus forts qu’eux », explique Ana Karadarevic, membre de l’initiative.
Comment ça marche ? Les volontaires reçoivent un lien via WhatsApp ou Signal les invitant à publier des messages bienveillants : un mot d’encouragement, un emoji cœur, ou simplement un message court. L’objectif n’est pas de répondre à la haine, mais de la rendre invisible. « Des centaines de publications positives poussent les messages haineux hors de vue, et nous influençons même les algorithmes », précise Karadarevic.
Un impact visible et mesurable
Les résultats sont là. Lors d’une récente vague de haine contre Femke Halsema, maire d’Amsterdam, après sa participation à un événement LGBTQ+, la « Petting Army » a contre-attaqué. En quelques heures, des centaines de messages positifs et de cœurs roses ont submergé les réseaux sociaux, reléguant les attaques à l’arrière-plan. Les hashtags #troetelleger (« armée des caresses ») et #hoopzaaiers (« semeurs d’espoir ») sont devenus viraux.
Cette méthode a un double effet : non seulement elle réduit la visibilité de la haine, mais elle dissuade aussi les auteurs de messages toxiques. « La haine est contagieuse. Mais si elle n’est pas visible, elle s’arrête », souligne Karadarevic. Une leçon de résilience numérique.
Une mobilisation qui grandit
Lancée il y a près d’un mois, la « Petting Army » organise deux à trois opérations par semaine. Le nombre de volontaires ne cesse d’augmenter, tout comme les signalements de personnalités politiques ciblées. « Nous recevons de plus en plus de demandes pour intervenir », se réjouit Karadarevic.
Cette initiative prouve que la bienveillance peut être une force collective. Elle rappelle aussi que chaque internaute a un rôle à jouer dans la qualité des débats en ligne. Et si la solution à la cyberhaine résidait dans notre capacité à semer de l’espoir ?
Et demain ? Une inspiration pour d’autres pays ?
Les Pays-Bas montrent la voie, mais cette méthode pourrait-elle s’exporter ? Plusieurs mouvements similaires émergent en Europe, inspirés par des initiatives comme les « Love Speeches » en Allemagne ou les « Brigades de la gentillesse » en France. La lutte contre la haine en ligne ne passe pas seulement par la modération, mais aussi par la mobilisation citoyenne.