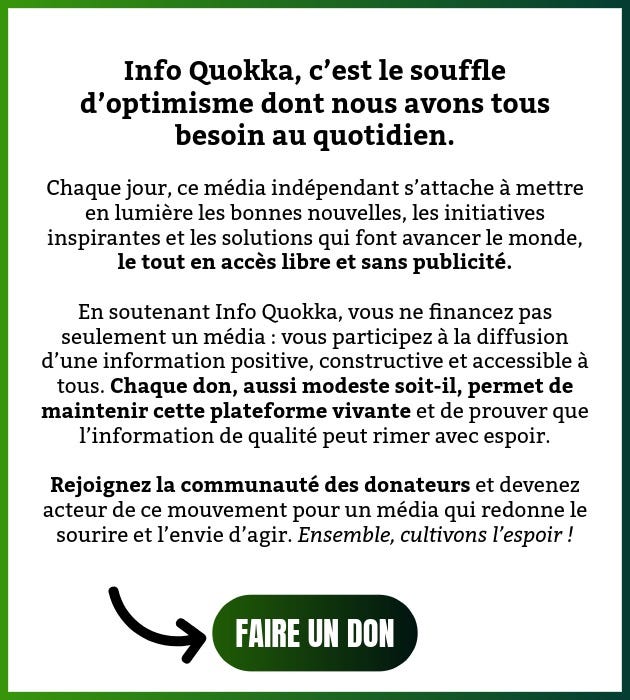Santé mentale : pourquoi la nature est un remède efficace en ville
Découvrez comment les espaces verts urbains réduisent les hospitalisations psychiatriques de 7 % selon une étude internationale. Un remède naturel et accessible pour la santé mentale.

Et si la solution pour réduire les troubles mentaux se trouvait… dans les arbres ? Une étude internationale, menée sur 20 ans et portant sur 11,4 millions d’admissions psychiatriques, révèle un lien clair : plus un quartier est vert, moins ses habitants sont hospitalisés pour des troubles mentaux. Les résultats, publiés récemment, montrent une réduction de 7 % des hospitalisations dans les zones les plus végétalisées. Une découverte qui pourrait révolutionner l’urbanisme et les politiques de santé publique.
Une relation dose-réponse : plus de vert, moins de crises
Les chercheurs ont utilisé l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI), une mesure satellitaire qui évalue la densité de matière végétale dans une zone. Leur conclusion est sans appel : il n’existe pas de seuil minimal pour bénéficier des effets positifs de la nature. Chaque augmentation de la verdure s’accompagne d’une diminution progressive des hospitalisations, un phénomène appelé relation dose-réponse.
Les troubles liés à l’usage de substances voient même une baisse de 9 %, tandis que les troubles psychotiques et la démence reculent respectivement de 7 % et 6 %. Des chiffres d’autant plus significatifs que 1,1 milliard de personnes souffraient d’un trouble mental en 2021, soit 14 % de la charge mondiale de morbidité.
Des bénéfices variables selon les pays et les saisons
L’étude, menée dans sept pays (Australie, Brésil, Canada, Chili, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Thaïlande), montre des disparités géographiques. Si le Brésil, le Chili et la Thaïlande enregistrent des améliorations constantes, l’Australie et le Canada font exception avec une légère augmentation des hospitalisations malgré plus de végétation.
Pourquoi une telle différence ? Les chercheurs évoquent le contexte urbain : la localisation des espaces verts (parcs, rues, zones industrielles), leur accessibilité, leur sécurité, et même la culture locale d’utilisation des parcs. En ville, une augmentation de 10 % des espaces verts peut réduire les admissions de 1 à 1 000 pour 100 000 habitants, selon les pays.
Les variations saisonnières jouent aussi un rôle : l’utilisation des espaces verts dépend de la chaleur, de la pluie, ou de la qualité de l’air. Une preuve que la conception des parcs doit s’adapter aux réalités locales.
Un appel à l’action pour les urbanistes et décideurs
Cette étude ne prouve pas un lien de causalité direct, mais ses résultats sont trop cohérents pour être ignorés. Les chercheurs insistent : verdisser les villes n’est pas qu’une question de climat ou de biodiversité, c’est aussi un levier pour la santé mentale.
Que faire concrètement ?
Créer des espaces verts de qualité : des parcs arborés, avec des bancs et des fontaines, plutôt que de simples bandes de gazon.
Rendre ces espaces accessibles : les relier aux transports en commun, ajouter des sentiers et un éclairage pour une utilisation toute l’année.
Cibler les quartiers denses et défavorisés, où l’impact sur la santé mentale sera le plus fort.
« Ne plantez pas des arbres pour une photo, mais pour changer les vies », résument les experts.
Quels espaces verts pour quels bénéfices ?
Toutes les formes de verdure ne se valent pas. Une pinède, une mangrove, ou un square urbain ombragé n’offrent pas les mêmes avantages. Les recherches futures devront préciser quels types d’espaces verts sont les plus bénéfiques, et comment leur qualité, sécurité et accessibilité influencent les résultats.
Des études complémentaires, notamment en périodes de canicule ou d’hiver rigoureux, sont aussi nécessaires. C’est dans ces moments que la conception des parcs fait toute la différence.
Conclusion : une solution simple, mais puissante
Pas besoin de déménager à la campagne pour profiter des bienfaits de la nature. Un parc bien entretenu, une rue ombragée, ou un chemin vert vers les transports suffisent à réduire les crises psychiatriques à grande échelle.
Cette étude offre une stratégie gagnante : améliorer la santé mentale tout en rafraîchissant les villes, purifiant l’air et boostant la biodiversité. Une solution concrète, peu coûteuse, et accessible, à la portée de chaque municipalité.
Et si la clé d’une meilleure santé mentale était… juste sous nos yeux ?