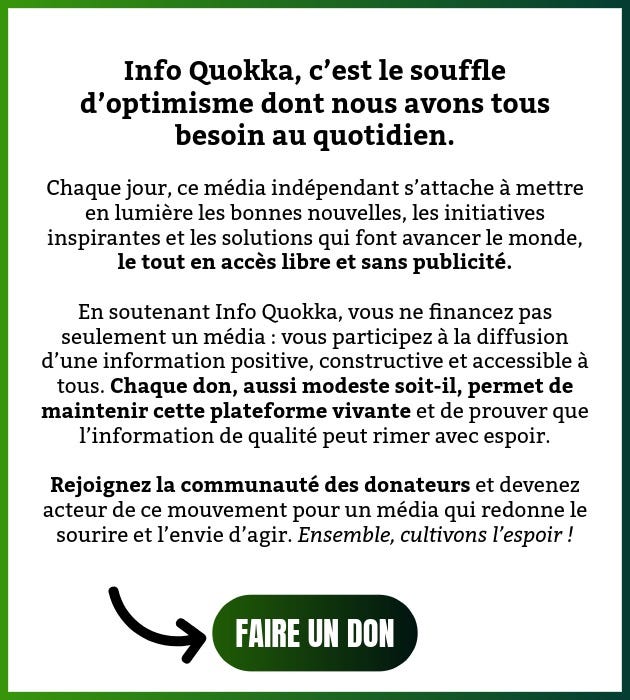Victoire juridique majeure : les États doivent évaluer l’impact climatique des forages
La CEDH établit un précédent historique : les États doivent évaluer l’impact climatique global des projets pétroliers avant toute exploitation. Une avancée majeure pour les militants écologistes.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de marquer un tournant dans la lutte contre le changement climatique. Dans l’affaire Greenpeace Nordic et autres contre la Norvège, la Cour a établi que les États doivent évaluer l’impact climatique global des projets pétroliers et gaziers avant d’autoriser de nouvelles exploitations. Bien que la Norvège ne soit pas reconnue coupable de violation des droits humains, cette décision crée un précédent juridique majeur. Les ONG et les citoyens disposent désormais d’arguments solides pour contester les projets polluants.
Un jugement aux implications bien plus larges qu’il n’y paraît
À première vue, la décision de la CEDH peut sembler timide. La Norvège n’a pas été condamnée pour avoir accordé des permis d’exploration en mer de Barents. Pourtant, les juges ont souligné une lacune cruciale : les évaluations climatiques réalisées par Oslo étaient incomplètes. Désormais, avant d’approuver de nouveaux forages, les autorités norvégiennes devront étudier l’ensemble des émissions générées par l’extraction et la combustion des hydrocarbures, où qu’elles aient lieu.
« Ce jugement crée un précédent important : les gouvernements ne peuvent plus approuver des projets causant des dommages climatiques irréversibles sans contrôle judiciaire », explique Sébastien Duyck, avocat au Centre pour le droit international de l’environnement (CIEL). Cette obligation s’étend à tous les pays membres du Conseil de l’Europe, ouvrant la voie à des recours similaires dans d’autres États producteurs de pétrole ou de gaz.
Pourquoi cette affaire est-elle si symbolique ?
L’affaire remonte à 2016, lorsque Greenpeace Nordic, Nature and Youth et six militants ont attaqué la Norvège pour avoir ouvert des zones de la mer de Barents à l’exploration pétrolière. Leur argument ? Ces licences violaient leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.
Les tribunaux norvégiens avaient rejeté leurs demandes, reconnaissant les risques climatiques, mais sans annuler les permis. En 2021, les plaignants se sont tournés vers la CEDH. Cette semaine, la Cour leur a donné raison sur un point essentiel : l’évaluation climatique initiale était insuffisante. « Aucune production pétrolière norvégienne actuelle ne satisfait à ces nouvelles exigences », souligne Cathrine Hambro, avocate à la Cour suprême norvégienne.
Une obligation légale inédite pour les États
La CEDH a confirmé que les gouvernements doivent désormais prendre en compte l’ensemble des conséquences climatiques de leurs projets pétroliers et gaziers. « Le point le plus important est que l’impact climatique doit être intégré dans les décisions, ce que les pays producteurs ont toujours tenté d’éviter », déclare Clemens Kaupa, professeur de droit à la Vrije Universiteit Amsterdam.
Cette décision renforce le cadre juridique pour les militants écologistes. « Les ONG et les particuliers ont désormais des fondements plus solides pour contester les projets d’énergies fossiles », ajoute Sébastien Duyck. Même si le seuil des droits humains n’a pas été franchi dans ce cas précis, l’obligation d’évaluer l’impact global des émissions – y compris celles liées à la combustion – est une première.
Quelles conséquences pour l’industrie pétrolière ?
Les compagnies pétrolières et les États producteurs ne pourront plus ignorer les répercussions mondiales de leurs activités. « Cela signifie que les gouvernements devront justifier pourquoi ils autorisent de nouveaux forages, malgré les risques climatiques », explique Cathrine Hambro.
Pour la Norvège, troisième exportateur mondial de gaz, cet arrêt pourrait ralentir l’expansion de ses activités en mer de Barents. « Les projets futurs devront prouver qu’ils respectent les objectifs climatiques, ce qui sera difficile », estime Clemens Kaupa.
Cette décision pourrait aussi inspirer d’autres juridictions. « D’autres cours, comme la Cour interaméricaine des droits de l’homme, pourraient suivre cet exemple », prédit Sébastien Duyck.
Un espoir pour les actions climatiques en justice
Les « procès climatiques » se multiplient à travers le monde. En 2021, un tribunal néerlandais a ordonné à Shell de réduire ses émissions de 45 % d’ici 2030. En France, l’État a été condamné pour « carence fautive » dans la lutte contre le réchauffement.
L’arrêt de la CEDH s’inscrit dans cette dynamique. « Il montre que les droits humains et la protection du climat sont indissociables », affirme Cathrine Hambro. Les militants espèrent désormais que d’autres pays, comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne, seront contraints de revoir leurs politiques énergétiques.
Un signal fort à quelques mois de la COP30
Alors que la communauté internationale se prépare pour la COP30, cet arrêt envoie un message clair : les États ne peuvent plus fermer les yeux sur l’impact de leurs choix énergétiques. « La justice climatique avance, même si c’est pas à pas », conclut Sébastien Duyck.
Pour les ONG, cette victoire juridique est un outil précieux. « Nous allons l’utiliser pour bloquer de nouveaux projets pétroliers en Europe et au-delà », annonce Greenpeace Nordic.